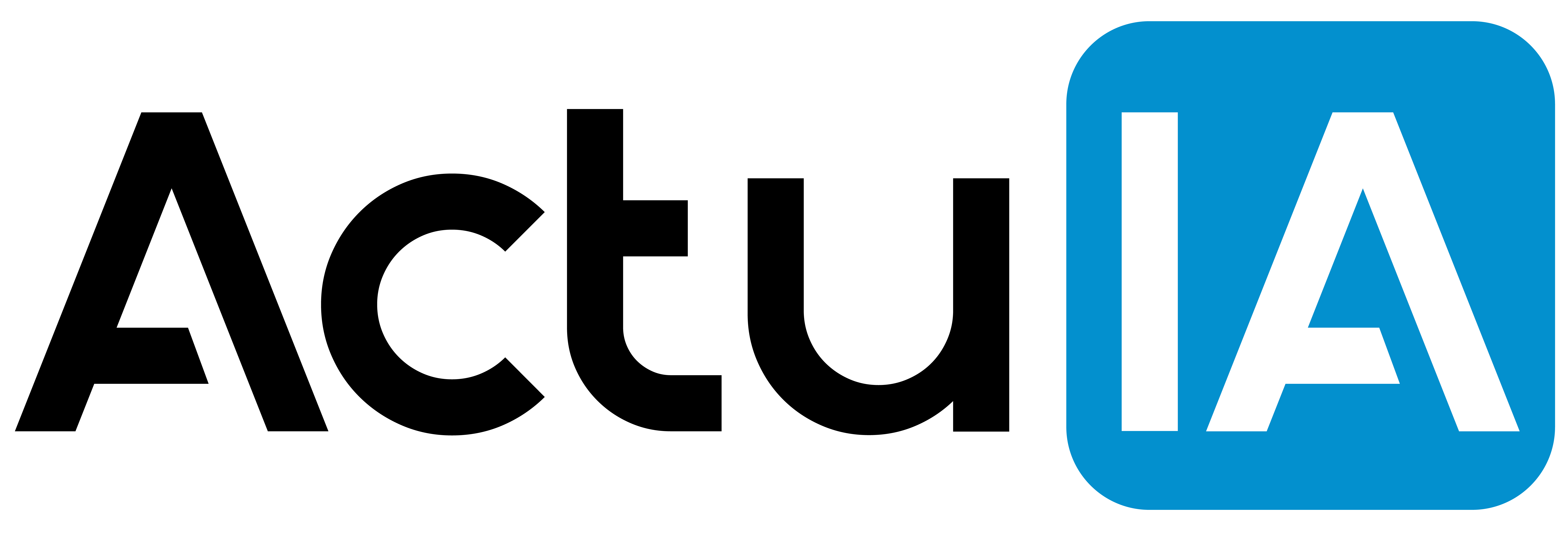Selon le "Rapport sur la technologie et l’innovation 2025", lancé officiellement ce 7 avril par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le marché de l’IA pourrait atteindre 4,8 billions de dollars d’ici 2033, soit un niveau équivalent au produit intérieur brut de l’Allemagne. L’agence onusienne anticipe également que 40 % des emplois dans le monde pourraient être affectés par l’automatisation induite par l’IA, une projection qui fait écho aux estimations du Fonds monétaire international. L'un comme l'autre alertent d'ailleurs également sur un risque d’aggravation de la fracture numérique entre économies avancées et pays en développement.
La CNUCED, organe de l’ONU qui a célébré ses 60 ans l’an dernier, a été créée pour aider les pays en développement à mieux s’intégrer dans l’économie mondiale. Elle vise à promouvoir un commerce plus équitable et inclusif, en s’appuyant sur des politiques favorisant la croissance économique et le développement durable.
L'édition 2025 de sa série de rapports sur la technologie et l’innovation, initiée en 2010, intitulée "Une intelligence artificielle inclusive pour le développement", cherche à guider les décideurs politiques à travers le paysage complexe de l’IA et les aider à mettre en place des politiques publiques qui garantissent une croissance technologique plus équitable. Il identifie pour cela trois leviers essentiels : l'infrastructure, les données et les compétences.
Une dynamique de concentration technologique
Parmi ses conclusions, le rapport met en lumière la concentration des investissements en IA : près de 40 % des dépenses mondiales de recherche et développement (R&D) sont aujourd’hui entre les mains d’une centaine d’entreprises, principalement basées aux États-Unis et en Chine. Cette concentration renforce une dynamique de monopole technologique, où les pays dotés d’un écosystème numérique avancé voient leur compétitivité s’accroître, tandis que les économies émergentes peinent à développer leurs propres infrastructures et compétences.
Dans ce contexte, les principaux acteurs du secteur, tels que Nvidia, Microsoft ou Apple, affichent une capitalisation boursière comparable, voire supérieure, au PIB de l’ensemble du continent africain. Ce déséquilibre dépasse largement le cadre financier : il reflète des écarts structurels en matière d’infrastructures, de talents et de souveraineté numérique, qui influencent durablement les rapports de force économiques.
L’automatisation : un impact différencié selon les régions
Les emplois de bureau et administratifs seront les plus touchés par l’IA, impactant surtout les économies avancées. Dans les pays à faible revenu, où la main-d’œuvre à faible coût a constitué un avantage concurrentiel, cette proportion est moindre, mais l’effet indirect pourrait être plus déstabilisant.
La CNUCED insiste toutefois sur la nécessité de nuancer ce constat : l’IA, si elle est accompagnée de politiques publiques actives en matière de formation, d’innovation locale et d’accès équitable aux données, peut également favoriser l’émergence de nouveaux secteurs et renforcer les capacités productives.
Vers une gouvernance plus inclusive de l’IA
Le rapport souligne par ailleurs que près de 118 pays, principalement des économies du Sud, restent absents des discussions mondiales sur la gouvernance de l’IA, renforçant ainsi la domination des grandes puissances numériques.
Face à ces risques d’exclusion technologique, le rapport plaide pour une gouvernance mondiale plus inclusive. Il propose notamment la mise en place d’un mécanisme de divulgation publique des usages de l’IA, le développement d’infrastructures partagées ainsi qu'un appui aux modèles open source. Il appelle également à une coopération internationale accrue afin de limiter les disparités technologiques.
Concluant :
"L’IA peut être un catalyseur de progrès, d’innovation et de prospérité partagée, mais seulement si les pays façonnent activement sa trajectoire".